Regard décalé sur l’écologie
REGARD DÉCALÉ SUR L'ÉCOLOGIE
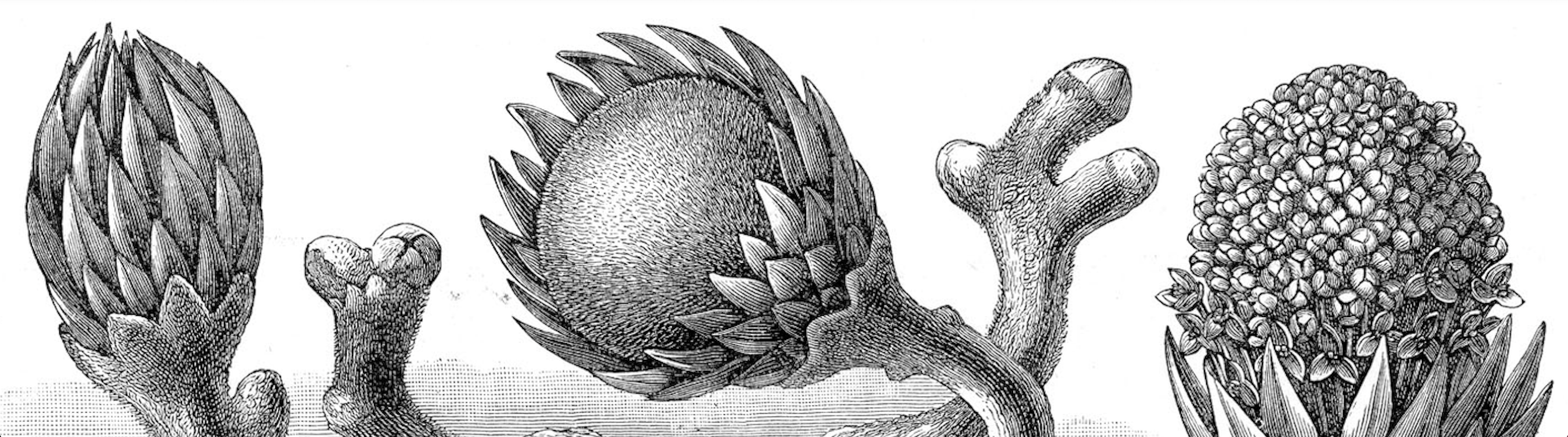
A l’occasion de la sortie de deux ouvrages (L’existence écologique, par l’économiste Christian Arnsperger, et Pourquoi nous voulons tuer Greta, par la psychanalyste Bénédicte Vidaillet), Emilie, doctorante en sociologie clinique au sein d’Astrées, propose de décaler notre regard sur notre rapport à la nature pour répondre à la question fondamentale : pourquoi les atteintes au climat et à la biodiversité se poursuivent, alors que les connaissances sont partagées sur le sujet depuis des décennies?
Les réponses apportées par ces deux universitaires ont un point commun : la peur de la nature, qui serait au cœur de toute action humaine.
Point important : leur démonstration respective s’inscrit volontairement dans le cadre de notre pensée moderne et occidentale, marquée à la fois par le dualisme entre “nature” et “culture”, et l’importance de la technologie. Pour Christian Arnsperger, c’est le déni de la finitude, celle de l’être humain et du monde, qui a permis la mise en place d’une logique productiviste. Pour Bénédicte Vidaillet, c’est l’envie, affect au potentiel destructeur, et la pulsion de mort présente en chacun de nous au même titre que la pulsion de vie qui sont déterminantes dans les mécanismes en jeu, à savoir des racines inconscientes qui nous poussent à maitriser voire supprimer cette nature fantasmée comme menaçante.
Une peur archaïque de la nature au fondement de la Modernité
Dès 2013, l’économiste allemand Christian Arnsperger, avait placé dans son projet d’humanisme écologique la peur comme point de départ à notre histoire récente (celle de la modernité). La finitude, comprise à la fois sur le plan des ressources et de la vie humaine, est un fait existentiel indéniable. Or, le déni de celle-ci « s’enracine dans une indéniable peur de la nature autour de nous et en nous – une peur qui a donné naissance, dans l’Occident moderne, à la logique consumériste / productiviste / croissanciste » (Arnsperger, 2013). Cette fonction palliative valait aussi pour la rationalité économique, qu’il analysait comme un « « mécanisme de défense contre l’angoisse existentielle ».
La psychanalyste Bénédicte Vidaillet développe également cette idée en repartant de la thèse de Freud dans Malaise dans la civilisation : « l’angoisse devant la nature est un moteur, un mobile souterrain puissant du développement culturel de l’humanité » (Vidaillet, 2023, p.44). Freud expliquait d’ailleurs que cette angoisse était présente quel que soit le niveau de développement culturel atteint. Dans son nouveau livre, l’autrice nous rappelle par de nombreux exemples que la vision fantasmée de la nature, telle que nous l’héritons et la reproduisons, est angoissante à plus d’un titre : imaginée hostile, elle est aussi en capacité à se développer en dehors de notre contrôle, une toute-puissance que ne possède justement pas l’être humain et qui nous renvoie, de manière insupportable, à notre condition de fragilité. « Ce qui, dans la « nature », nous menace fantasmatiquement est indissociable de son caractère vivant, [de son imprévisibilité] et du fait que cette vie se déploie sans nous » (op. cit, p.59).
Le culte du progrès en réponse à cette peur
L’Homo economicus, théorie qui voit l’être humain comme un être rationnel cherchant à maximiser ses intérêts particuliers, a inondé la science économique mais aussi nos politiques publiques depuis les néoclassiques jusqu’à aujourd’hui. Christian Arnsperger nous explique que cette vision est le produit d’une histoire politique vieille de plusieurs siècles : « c’est en cherchant à repousser l’échéance de la misère et de la famine que s’est constituée la théorie économique classique [Malthus et Ricardo]. Le progrès technique et la révolution industrielle surent démentir ces prédictions macabres mais, au lieu d’anéantir l’effroi existentiel qu’elles avaient manifesté, ne firent que le reconfigurer ». (Arnsperger, 2023)
Dans la Modernité, les avancées scientifiques transformant en profondeur nos sociétés, n’auraient en effet pas fait disparaître la peur évoquée, mais l’auraient simplement « soulagée » pour mieux la refouler, au prix d’une logique où « le désir se transforme bientôt en besoin : les biens matériels jadis considérés comme des luxes, deviennent des nécessités ». Il s’agit de notre insatisfaction chronique qui alimente une « course sans fin ». Celle-ci serait alors « le refoulement d’une terreur devant notre propre finitude ».
Dans le culte du progrès, rien n’est jamais atteint ou suffisant, et le présent n’est qu’une étape transitoire pour atteindre le “mieux”. La psychanalyste repart quant à elle de la théorie lacanienne du manque, constitutif de l’être humain, pour faire le lien avec nos modes de vie qu’elle qualifie d’« économie de la jouissance, ou plus précisément du manque-à-jouir, qui est introduit l’attente, sans cesse renouvelée, du gain de jouissance et du « plus » à venir, quel qu’il soit » (Vidaillet, 2023, p.174). Cette absence de fin ou de limites, au cœur de nos modes de vie, rend ainsi impossible d’intégrer l’idée même que nous vivons dans un monde limité.
La science & technique comme “bon objet”
Bénédicte Vidaillet démontre par ailleurs que nous avons répondu à cette peur archaïque de la nature par un autre mécanisme de défense : le clivage, entre un “bon objet” et un “mauvais objet” (selon la théorisation de Mélanie Klein). Notre culture aurait opéré un clivage entre la nature d’une part et les sciences et techniques d’autre part, nous permettant alors de nous réfugier « sur le bon objet idéalisé : la science et la technologie auxquelles nous nous sommes tant identifiées et qui, par le progrès qu’elles sont censées apporter, nous protégeraient de la toute-puissance imaginaire de la nature ? » (op. cit, p.109). Une manière d’éclairer à quel point toute critique envers le “technoscientifique” est immédiatement disqualifiée, au risque de revenir “au modèle Amish” (!).
En guise de conclusion...
Ces réflexions mettent en lumière un constat provocateur, qui nous inviterait en contre-point à accepter notre vulnérabilité commune, à repérer la pulsion de mort en nous (de toute façon présente) et se laisser affecter par la nature sans avoir peur d’être annihilé.e par elle. C’est ce que nous propose Bénédicte Vidaillet en conclusion de son ouvrage. Christian Arnsperger, au-delà de cette “réorientation de nos pulsions fondamentales et de nos désirs” qu’il appelle aussi de ses vœux, fait appel au “principe de suffisance”, c’est à dire l’idée de faire “un peu moins de ce qui serait possible”… Une idée révolutionnaire si on l’applique aussi au travail et aux organisations !
Sources : Arnsperger, C. (2023). L’existence écologique. Critique existentielle de la croissance et anthropologie de l’après-croissance. Seuil, « Anthropocène ». | Arnsperger, C. (2013). « Fonder l’économie écologique : Crise environnementale, crise économique et crise anthropologique ». Revue d’éthique et de théologie morale, 276, 93-120. | Vidaillet, B. (2023). Pourquoi nous voulons tuer Greta. Nos raisons inconscientes de détruire le monde. Erès, « Sociologie clinique ».